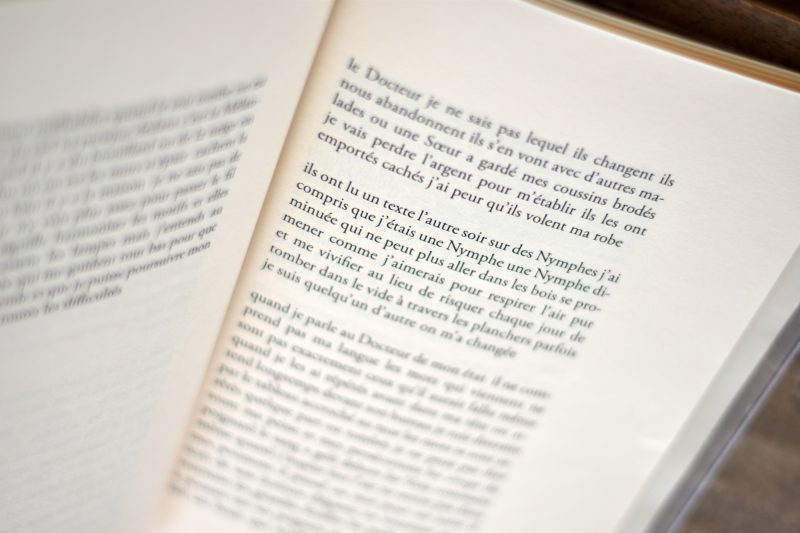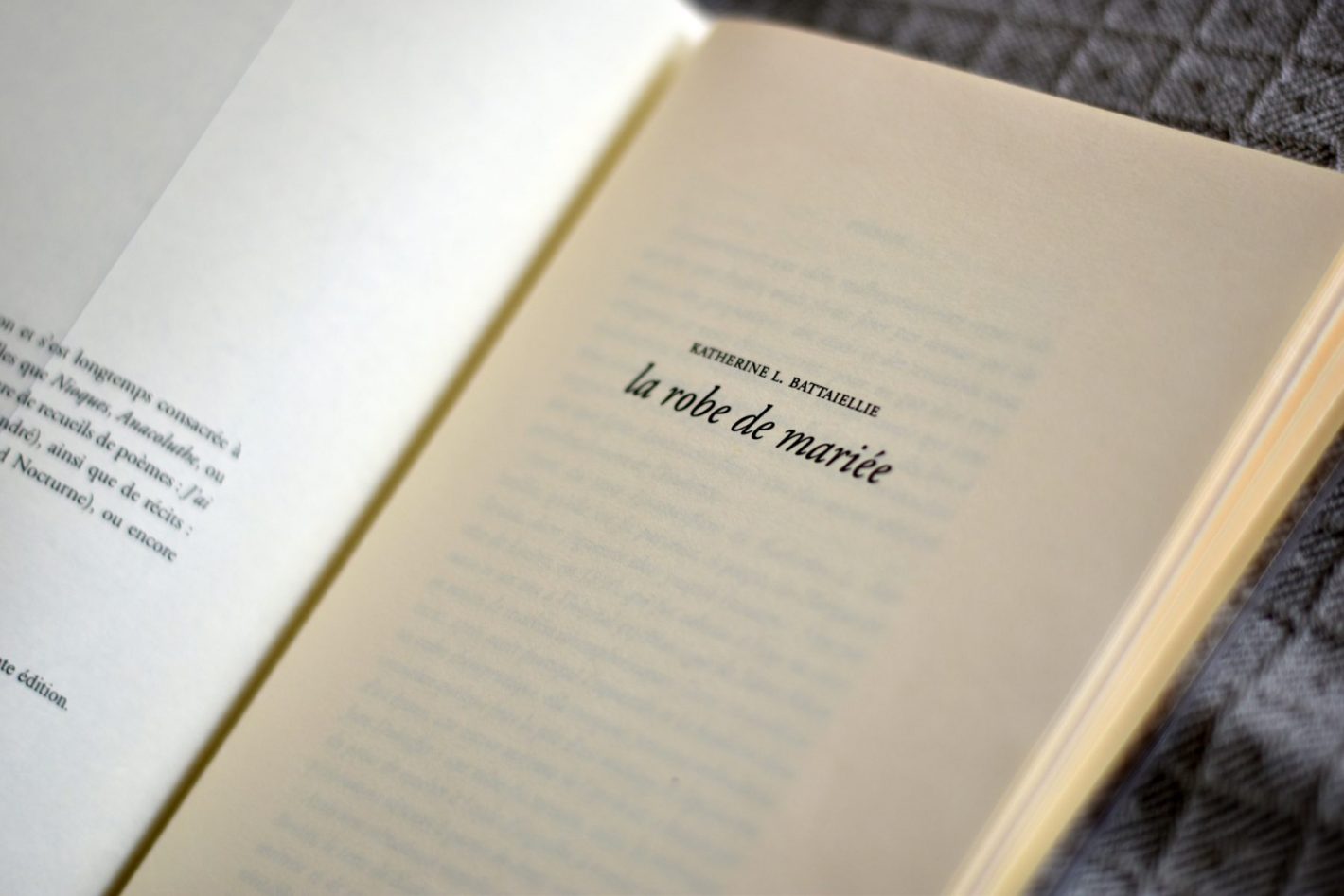Autour et sur « La robe de Mariée », texte de Katherine L. Battaiellie, aux éditions Marguerite Waknine
J’ai encore lu un cahier des éditions Waknine. Pourtant, ma liste de lecture est toujours aussi longue, et dernièrement, je retrouve ma vieille manie des « livres en chantier ». Mais voilà, ces petits cahiers m’attirent. En particulier les textes rares qu’ils exhument (ma lecture d’In Abstracto d’Urmuz).
Instinctivement, je cherchais dans leur catalogue à renouveler ma bonne expérience de lecture, et m’arrêtais très vite sur deux de la collection « livrets d’art » : « La vie des Basiles » de René Daumal, pataphysicien, et « La robe de Mariée » de Katherine L. Battaiellie. Je savais aussi, à je ne sais quoi, que je lirais le second en premier. Intuition confirmée par la lecture des premiers mots. Zou !
Donc, j’ai lu avec plaisir et surprise « La robe de mariée » de Katherine L. Battaiellie. Pourtant, le livre me pose un véritable dilemme moral. Car si le texte est simplement merveilleux, son sujet devrait me gêner : il évoque la robe de mariée fabriquée par Marguerite Sirvins pendant ses années d’internement psychiatrique, c’est-à-dire toute la fin de sa vie…
Car voilà, j’ai un problème avec « ça », l’Art brut en général. Eh oui, j’ai même un problème avec Dubuffet en particulier. Mais je sais que c’est un sujet délicat, que je m’attaque ici à l’un des piliers majeurs d’une de ces mythologies sentimentales de l’Art du XXe, l’une de ses si dangereuses déresponsabilisations de l’artiste qui ont mené à la fin du siècle dernier à des catastrophes sociales pour les producteurs de formes esthétiques. Je me promets ici de faire un de ces jours une lecture commentée de « l’asphyxiante culture » de Dubuffet. Mais pour l’instant, passons.
Disons rapidement que, considération vaguement « socialement décolonisée », je ne peux pas ne pas concevoir cet Art dit brut comme un abus de la réception bourgeoise, et l’estampille « art brut », comme une violence sociale qui vient médailler une détresse individuelle, comme ces officiers qui plantent l’aiguille de la médaille dans le torse de leurs soldats les plus involontairement héroïques.
Qu’estampiller « Art brut », c’est souvent s’attacher au fétiche d’une vie terrible, et souvent d’une mort de chien.
Après tout, je pourrais accepter ça pour ces artistes « involontaires », puisqu’on ne fait pas différemment avec toutes ces petites croûtes insensées, ces malaxages maladroits, ces ouvrages déviants encouragés par des médecins et des infirmiers, qu’avec tous les martyres de la culture, qui par ironie, se sont eux-mêmes baptisés « maudits ». Le tragique d’une vie, des vies des fous comme des artistes, serre le coeur une seconde, avant que la vie, la nôtre — la vôtre surtout — ne reprenne son empire bien plus sûrement grotesque que tragique.
Et pourtant, je me souviens de mon malaise, en visitant une grande exposition d’Art brut. Devant ces indices de vies, pour la plupart carcérales, qui nous seraient insoutenables.
Qu’on rachète, pour répondre à une collective culpabilité peut-être, ces traces de fiasco en oeuvre d’Art ne rachète rien, ne sauve rien, et ceci, quelle que soit la douloureuse beauté qu’on leur découvre soudain (moi le premier). Une compensation ? Comme Vian enfin en Pléiade ? (L’annonce m’a rendu triste), ou comme tous les morts que nous applaudissons trop tard ? Et je ne m’exclus pas du jugement moral que je porte sur la panthéonisation de nos martyrs (déjà évoqué dans « Le deuil de Laura Ingalls« ), mais je me garde de ces confusions romantiques qui font tout confondre et finissent par une mise sous tutelle sociale, médicale et culturelle des auteurs et artistes…
Attention : il y a parmi les fous, des artistes. Et il y a des fous parmi les artistes, comme parmi vous tous. Et de quoi parlons-nous ? Séraphine Louis, par exemple, était une vraie peintre simplement « non bourgeoise », et c’est une injustice de la classer parmi l’art brut, et donc tant d’involontaires, de machines folles et obtuses récupérées comme décoration, alors que cette dernière a simplement fait ce qu’elle voulait faire : peindre, au sens plein du terme. Mais passons, passons ! J’ai dit qu’il faudrait y revenir.
Et il y a ce livre, le sujet, ce petit cahier signé par Katherine L. Battaiellie (édité encore par les épatantes éditions Marguerite Waknine), qui se fascine pour l’ouvrage tragique de Marguerite Sirvins, produit tragique, chargé du tragique d’une douleur sans issue d’un destin sans issue, verrouillé dans sa boucle tragique, ou son point de croix, sans chemin, immobile, lent écroulement vers la mort d’une tragique anti-Pénélope.
Et je comprends parfaitement que cet objet fascine, car la robe de Marguerite Sirvins est une relique, sacrée, car la chose qui reste, vrai fétiche qui témoigne du lent calvaire d’une hermétique folie. Fétiche plus sacré peut-être qu’une « vulgaire » oeuvre d’Art, car Marguerite voulait se marier, comprenez-vous ? Elle voulait se marier ! Et c’est bien ça qui comptait pour elle, et ce n’est pas à vous de décider d’une autre finalité à son ouvrage !
Et il faut cesser de nier, d’anesthésier, de confondre toutes les douleurs.
La robe « Sans titre »
Ce « sans titre » que l’Art brut si bourgeois a accolé à cette robe me reste en travers de la gorge. Car « Mariée » est un titre, et quoi qu’on pense du mariage, (je ne le suis pas, marié),« Mariée » est bien un titre, un titre fort, espérant reconnaissance générale, tout autant que « Colonel » ou « maréchal », ou même « Président »…
Mais l’indignité du « sans titre » accolé semble nier son titre véritable, parce qu’il en est un, de titre « de substitution », ce « sans titre » désignant brutalement la robe comme œuvre d’Art, et donc voulant, aussi maladroitement qu’une dame de charité tendant des confitures à un mourant, offrir un titre noble à ce qui ne le serait pas. En quel honneur ? En l’honneur de l’ennoblissement forcé, de la récupération « pour soi », de l’insertion dans un cadre symbolique exogène, geste parfaitement colonial, parfaitement brutal et mortifère, qui dénie et détruit le véritable cadre d’apparition de cette robe pourtant déjà si titrée par son auteur. Car si le geste n’était pas artistique, il a un auteur, Marguerite, et naît d’une volonté farouche, celle de préparer son mariage. Ce « sans titre » détruit donc ce qu’il expose, plus encore qu’une volée de mites.
« La robe de Mariée » de Katherine L. Battaiellie
Tout ça pour dire à quel point ce qu’a tenté Katherine L. Battaiellie était casse-gueule, pour moi, comme ça pouvait, à un fil près (sic!), passer pour une indignité de plus (je n’ai pas lu l’autre écrivain fasciné par la robe).
De manière à peu près générale, le phénomène de l’Art brut est une paréidolie : ça ressemble, alors c’est. Si tous les retraités et tous les malades qu’on occupe dans les ateliers de peinture, sculpture, broderie, pâte à sel, etc. du monde sont des artistes, alors que sont les artistes ? Vous savez ( pas ?), ces gens à vocation, qui doivent se construire souvent dans la douleur aussi, contre vous et le reste du monde, pour se coltiner la question des formes, de la culture, de l’Histoire, et quand ils en ont la force, parfaitement consciemment, volontairement, tout déconstruire pour reconstruire… ces gens-là, que sont-ils ? (Je vous raconterais un jour ce qu’ils sont devenus).
Mais si l’audace de Katherine L. Battaiellie met le doigt sur « mon » problème moral, puisqu’a priori, j’ai un « problème » avec cet Art brut, alors pourquoi ai-je tant goûté ce livre-là ?
Parce que l’œuvre est là, dans le texte, qui d’une fascination bien compréhensible pour cet objet chargé, pour le moins, produit un texte d’une beauté rare, composé avec art d’une fluide logorrhée, miraculeuse, quasi médiumnique, qui s’écoule de ce minuscule cahier jusqu’au cerveau, malade ou pas, qui voudrait bien le goûter.
Et l’évidence ici, est que Katherine L. Battaiellie est une artiste, une écrivaine remarquable, quand marguerite ne le fut jamais, car pour être un artiste, il faut à minima le vouloir.
C’est là, par la réussite esthétique, sensible, intelligente, que Katherine L. Battaiellie gagne contre mes arguments, contre mes réticences de moraliste à la petite semaine, en redonnant son titre à « la robe de mariée » celui-là volé par les expositions et les sites internet d’Art, et phénomène incroyable, qu’elle redonne mot à la douleur d’une âme que l’ouvrage vain n’aura jamais apaisée. Elle donne un nouvel écho au deuil d’un amour, cet écorchement moral qui avait été étouffé par la vitrine des expositions.