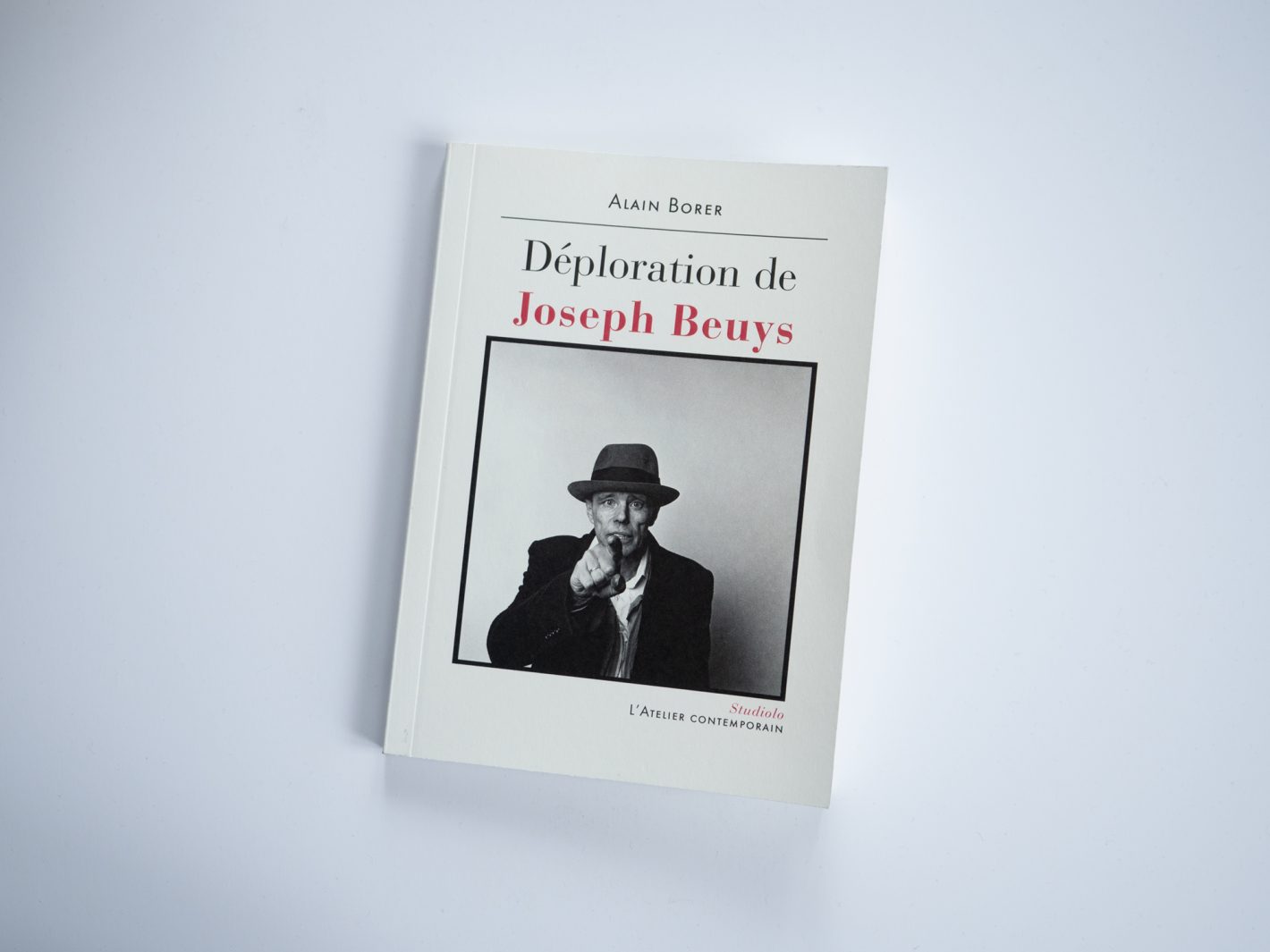Un petit livre sur Beuys aux éditions L’Atelier contemporain. Un petit livre comme je les aime. Un livre d’Art comme je les aime (peut-être parce que, adolescent fauché, je glanais les plus petits livres d’Art que je pouvais trouver). Un petit livre d’Alain Borer qui, donc, passe de Rimbaud à Beuys, logique, deux saints modernes. Et c’est son angle. De Borer, je n’ai lu, avec plaisir, que la suite de son enquête poétique sur les traces du fétiche Rimbaud. Ici encore, plaisir de lecture, fluide, l’écriture d’Alain Borer, bel écrit sur l’Art, sans les pleurs du titre, mais avec une évidente sensibilité à l’œuvre comme à l’artiste. Je partage cette sensibilité à Beuys. Beuys, anti-Rimbaud, anti-Dada, oui, Beuys, je l’ai toujours perçu comme sentimental. Beuys, l’ironique sentimental répondant au cynique Duchamp. Mais c’est peut-être moi qui suis sentimental, qui projette quelque chose de chaudement mémoriel dans les étranges propositions de Beuys. Si je m’arrête un moment et que je laisse venir mes souvenirs de visite, ils se mêlent avec des réminiscences des ateliers de mes grands-pères, lieux sombres zébrés d’étagères encombrées de bidon contenant et débordant de produits anciens, mélange d’odeur lourde et chimique, mystères, poussières et toiles d’araignée. D’autres souvenirs aussi, de plomberie, de la graisse et de l’étoupe… En y repensant, je me dis qu’il y avait des accroches pour que j’accroche à Beuys. Et pourtant, je n’ai pas le souvenir d’avoir eu un cours sur l’œuvre, mais sur l’artiste oui. Plus précisément, un cours sur le marketing de l’Art. On nous invitait à « trouver un truc, un truc, un, et s’y tenir, décliner, les galeries n’aiment pas qu’on change, qu’on expérimente, et trouver un look, oui, et s’y tenir, oui, comme le chapeau de Beuys ! ». Voilà qui aurait pu m’en dégouter, de Beuys, mais seul le cours était dégoûtant, gluant dans son cynisme et son abdication culturelle face aux lois du marché. Je me souviens qu’on rétorquait « et Picasso ? ». « Picasso ? C’est l’exception. Il pouvait se le permettre ». C’est là que la découverte des aquarelles de Beuys, douces, élégantes, chaudes, sensibles, sentimentalement liées à l’histoire très classique de l’Art, toutes qualités qui semblaient transgressives dans le cadre de l’enseignement artistique que je recevais alors, dans la fin du grand retournement des valeurs qui fait qu’il était normal de s’enfermer avec un coyote, mais inimaginable de faire de petites aquarelles… « On ne fait plus ce genre de choses ! » entendait-on. Beuys libre, si. Mais un autre professeur (poète) répétait parfois, sèchement, vulgairement, « on est un con ».
Je comprends qu’on tourne autour des installations de Beuys, qu’on y traîne, qu’on s’en imprègne, qu’on laisse venir. Il a quelque chose que d’autres n’ont pas ( je me rends compte, dans l’ordre des intimités mentales, que Joseph Beuys l’engagé est paradoxalement classé en moi avec la narcissique Louise Bourgeois… ). Une séduction. Peut-être cette profondeur anthropologique, par un réseau subtil de fibrilles culturelles, qui relient ses objets aux fondations préculturelles comme aux ruines futures. Je pensais « rhizome » quand je l’ai lu page 59. Accord. Et j’aime cette idée des travaux mous, assez courants à l’époque. Mais il y a une opposition entre les sculpteurs simplistes qui rendent mou ce qui est dur, amusant une fois, ou rendent dur (durable) ce qui est mou, geste très classiquement réactionnaire (Koons), et la graisse de Beuys, qui va évoluer lentement, s’affermir peut-être, se rancir en commençant par les bords, les surfaces, pourrir tranquillement, mais sans jamais assurer de préserver sa forme. je me souviens de ça aussi, du tremblement mental, découvrant ce biais de graisse sur une chaise, que la chose était… fragile alors qu’exposée. Exposé prenant donc là le sens de « en danger ». Je ne sais pas si c’était la première fois que j’étais confronté à une œuvre fragile, voir potentiellement éphémère, parce que j’étais féru de philosophie zen à l’époque, mais oui, je trouvais ça terriblement audacieux de proposer à l’exposition quelque chose qui inspire la transgression, qui en entrave l’usage simplement symboliquement, et qui semble même provoquer le passage à l’acte destructeur. Évidemment, qui s’assoirait sur une masse de graisse dégoûtante ? L’instinct premier était instantanément bloqué par un instinct contraire, de répulsion au contact possible de cette masse gluante. Il était fort, ce Beuys !
Pour revenir au joli petit livre, il semble s’embrouiller quand arrive la question de l’humour, ou de l’absence d’humour de Beuys le clown blanc, qui ne déroge pas du genre qui entièrement le contient. Le genre est humoristique, Beuys aussi, et ses pièces sont drôles et même grotesques jusqu’au carnavalesque. Ce qui n’empêche ni gravité ni profondeur. Comme la quasi-intégralité de l’Art du XXe siècle dont on ne pourra jamais l’extraire. Mais le texte se reprend au chapitre suivant, puisqu’il faut bien confronter Beuys à la Shoah. Là encore, l’artiste se sauve par sa posture carnavalesque. Ses apparentes « répétitions » de ses embrigadements ne sont que des caricatures. Mais le carnaval est une répétition de la violence du pouvoir. Même si les rôles sont inversés, cette répétition ne remet rien en cause, elle est même la garante de la préservation de la hiérarchie et de l’ordre. Alors se pose la question de l’occultation de l’extermination de masse. Considérait-il que son méta-naturalisme chapeautait (sic !) toute l’histoire humaine ? Ce qui serait une manière de valider la mystique nazie. Là, je suis prêt à suivre l’auteur. L’occultation traumatique ne peut servir de cache-misère et les passes magnétiques de l’artiste ne comblent pas l’enfer. C’est peut-être là qu’il faut se garder d’attendre des arts plastiques ce qu’ils ne peuvent donner, et de leur accorder une importance qu’ils ne peuvent tenir… Et laisser Beuys où il est (comment l’Art pourrait-il être une panacée alors qu’il est un symptôme ?). Beuys, artiste, ne fait que continuer la mise en scène d’une mystique collective d’avant l’extermination avec des moyens internationaux actualisés, qu’il perpétue par-dessus l’extermination, sans se préoccuper, car ce serait se réduire au silence et à la contrition, des implications de cette mystique dans le drame. L’endroit où il n’est plus drôle du tout et qui ouvre le dernier chapitre, le « diagnostic » d’Alain Borer. Et ici plus de joli petit livre, mais un regard droit et salutaire sur les choses telles qu’elles se présentent. L’ironie, là, c’est que le livre entier répond à la syntaxe allemande en bouclant la démonstration à la toute fin d’un revers violent et imparable.
Alain Borer, Déploration de Joseph Beuys, chez L’Atelier contemporain 2021