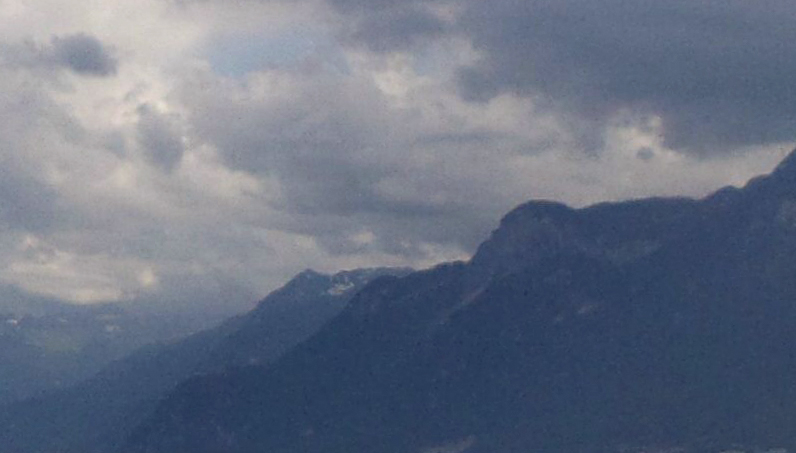Pendant mon court séjour à l’hôpital, j’ai lu le jour et la nuit avec une certaine obstination, tentant ainsi de négocier les attentes et les insomnies. Le jour, je relisais « Le réel et son double » de Clément Rosset, et la nuit, « Les enfants Tanner » de Robert Walser sur l’écran de mon téléphone réglé sur fond noir et basse lumière pour ne pas déranger mon voisin en souffrance.
Si je sais pourquoi j’exhumais de ma bibliothèque ce poche de Clément Rosset ; puisque tristement les gens se rappellent à notre souvenir au moment de leur disparition ; je me suis demandé pourquoi je m’infligeais ce premier roman de Robert Walser que je percevais rapidement comme niaiseux et suranné. Je savais bien pourquoi je l’avais mis dans mon téléphone avant de partir pour l’hôpital : « Les enfants Tanner » est le roman préféré du père de la narratrice dans « Je suis le genre de fille » de Nathalie Kuperman que j’ai lu il y a peu. Pourtant, rentré chez moi, je me suis surpris à continuer ma lecture de Walser. J’étais passé de l’agacement premier à la fascination, sans cesser pour autant de trouver le narrateur infantile et trop bien élevé, préfreudien, insupportablement présexuel et nous rejouant constamment une scène originelle de soumission à une mère sans affection. Le plus horripilant étant son masochisme social, son aveuglement quasi libidinal qui frôle la naïveté coupable, son apolitisme qui en fait le complice ravi des dominations arbitraires, des ordres autoritaires et des basses exploitations. Sauf que, je le comprenais rapidement, c’est ainsi qu’il se donne en témoin honnête et détaillé des oppressions qui le broieront bientôt, définitivement, pour le temps d’une bonne moitié de vie, sans qu’il en développe ni conscience claire ni révolte. Et c’est bien ainsi qu’il en est la victime. Robert Walser se donne en témoignage d’une servitude ancestrale, si intégrée qu’elle en est consubstantielle de l’être. Quelque chose en lui ne s’y résolvant pas, l’auto-internement sera la seule réponse qu’il trouvera à son inaptitude sociale, rejouant ainsi 22 ans plus tard le destin d’un grand frère brillant, brisé et interné, décrit dès 1907 dans ce premier roman (comme il y décrit sa mort de poète en marche). Mais plutôt qu’un roman prémonitoire, « Les enfants Tanner » représente un véritable roman-programme pour un Walser qui considérera toujours ses rébellions instinctives comme les symptômes d’une maladie très personnelle.
Si j’ai continué ma lecture malgré l’arrière fumet de vieux coucou suisse, c’est parce qu’avant son retrait du monde et l’arrêt de l’écriture, ce Bartleby bavard et passablement mythomane se donne et s’épanche en littérature. Et j’ai été rapidement captif de l’écriture, simple et lancinante, qui entraîne et intrigue d’une manière de conteur détaché et ironique, évitant toujours, continuelle digression, d’exposer réellement l’auteur, en en construisant même au fil des récits un portrait vacant, effacé, sans que jamais ces pseudofictions n’altèrent l’opacité du mystère Walser.
Et pourtant, je ne trouve pas « les enfants Tanner » si grand qu’on le vend parfois. Il est chaotique et change même de nature à mi-chemin. Mais il est inspiré et contient une grande promesse, une promesse d’une écriture qui s’émanciperait d’une trop « bonne éducation » et d’un ancrage profond dans ce que le XIXe siècle avait de plus empesé. Et en effet, cette promesse sera tenue plus tard dans (pour ce que j’en ai lu) « Le brigand » ou « La rose » par exemple, textes étonnants traversés par les expériences littéraires contemporaines et lorgnant déjà, fulgurance, vers les émancipations de la fin du XXe. En ça, et pour sa vie conforme à ces récits, les récits précédant souvent sa vie comme sa mort d’ailleurs, Robert Walser compte parmi les maudits chers à Verlaine.
(Photo d’illustration : Céline Guichard juin 2018)