Si l’on en croit Northrop Frye, le roman policier participerait d’une littérature naïve, et pire encore, sa « brutalité croissante » (dans le XXe siècle) s’approcherait « aussi près que l’art puisse le faire de la pure autosatisfaction morale d’une foule de lyncheurs ». Si l’on excepte la dose de basse morale qui préside à ce jugement, simple réaction d’une éducation bourgeoise euphémisée face à la culture populaire toujours reçue comme trop crue et trop violence, on pourrait objecter que la tension majeure du genre « polar », pour sa part « roman d’enquête », est celle de la quête des relations objectives entre les causes et les effets, et que, dans le récit même, cette quête très matérialiste s’oppose à la pulsion superstitieuse du lynchage… Et il n’est pas anodin que l’expansion du genre policier coïncide historiquement avec celle d’une science qui s’invente une rigueur.
Mark Anspach, autre lecteur de René Girard, s’engouffre et fait d’Œdipe Roi le premier roman policier (et sous-entends qu’il n’est pas seul à penser ça… Il aurait des complices ? C’est une meute ?), confondant ainsi l’archaïque et éternelle pensée magique et la tension matérialiste inhérente au genre né au XIXe… C’est bien pratique ! Et donc éludant que n’importe lequel des personnages de roman policier aurait tenté de prouver qu’œdipe n’était pas coupable, du moins de la peste, et démontrant au passage comment à lire la structure dépouillée de toutes anecdotes, on peut contredire tout un genre… Pourtant, entre surinterprétation et réinterprétation, lier Œdipe et le polar peut être utile… Même si j’ai toujours pensé qu’il y avait plus de boucs émissaires dans la réalité que dans la fiction et que je me méfie du filtre René Girard, il ne faut pas se priver de s’amuser tout en revenant toujours aux œuvres. Et donc à ce que disent vraiment les auteurs. Sinon de quoi parle-t-on ? (De soi).
Et à ce propos (de moi), c’est bien la première fois que je parle de polar, pour la simple raison que je n’en lisais pas (ou presque pas), et je n’en connaissais les codes que par le cinéma. Me trouvant donc incompétent, je ne me risquais pas à l’évoquer ici. Et puis, ces dernières années, j’ai rencontré Golo, François Darnaudet et enfin Frank, trois gars dont c’est une bonne part de la culture. Alors, frustré de ne pas savoir exactement de quoi il retourne et de ne pas toujours saisir les causeries de fin de nuit, j’ai demandé à Frank une liste de lecture, une liste de classiques, d’incontournables, pour enfin m’affranchir… Il n’est jamais trop tard pour bien faire ! Je suis donc rentré d’une nuit trop alcoolisée avec au fond de la poche une petite liste sulfureuse, froissée, tachée, et le lendemain (du matin), inspiré, j’ai décidé de commencer par deux auteurs de la liste : Jim Thompson et Chester Hime. Grand bien m’en a pris ! Chester Hime a écrit des merveilles d’énergie et d’humour, mais aujourd’hui, je commence par le premier grand choc : « The Killer inside me » de Jim Thompson, titre original pour éviter les deux mauvais titres français des deux traductions. Un texte superbe, massif, sec, rapide, sans fioriture, sans décorum. Un roc acéré de 65 ans, sanglant et froid, pas érodé pour un sou, parfaitement lisible.
Début du XXe siècle, un shérif adjoint d’une petite bourgade nous raconte un enchaînement d’événements tragiques, comme un polar, selon les codes du polar, chaque nouvelle action de sa part étant justifié par la logique du polar, c’est-à-dire ici selon la logique d’un homme qui tente et de se venger indirectement d’un autre qui aurait commandité la mort de son demi-frère. « The Killer Inside me », comme Œdipe, présente un bouc émissaire coupable. Et comble, laisse ce coupable nous raconter l’histoire. Mais, dans le premier degré du chef-d’oeuvre de Jim Thompson, nul subterfuge littéraire, comme chez Agatha Cristie (Le Meurtre de Roger Ackroyd) d’un assassin qui se cache derrière son propre récit, une supercherie somme toute presque enfantine. Ici, puisque nous sommes connectés à la pensée du tueur, quelque chose se cache au narrateur même, et donc au lecteur. Comme il ne nous est pas toujours simple de nous comprendre, en particulier dans nos pulsions, le narrateur ne se comprend pas. Ou plutôt, coup de génie de Jim Thompson, le narrateur se croit, s’imagine et s’interprète. Comme nous le faisons chaque jour. Nous le voyons en direct et en macro se construire une histoire qui ne coïncide pas exactement avec la vérité des faits. Littéralement, il s’aveugle, comme Œdipe…
Quelle histoire se raconte-t-il ? Celle d’un homme coincé dans un rôle qui ne lui convient pas, du parfait flic serviable et d’humeur égal, d’une telle patience qu’il peut gérer les pires situations de crises, mais qui secrètement, craque parfois et se laisse aller à des pulsions. Prisonnier d’une société à la morale étriquée ou bienséance et religion servent au contrôle de tous par tous, ses actions, dans ce cadre, ne sont qu’une fuite en avant d’un homme qui tente de s’en sortir, de trouver sa liberté et son expression, perpétrant un crime pour effacer le précédent, pris dans une destructrice fuite en avant avec à l’origine, dans son enfance, un accident malheureux que nous avons du mal à identifier car pour le personnage même le souvenir en est trouble.
Ainsi, d’une certaine manière, ce tueur s’excuse de ce qu’il fait, considérant qu’entre l’accident de son enfance et l’injustice du meurtre de son demi-frère, il est bien obligé de faire ce qu’il a à faire. Bien sûr, la pulsion sadique n’est pas absente de la première moitié du livre, mais elle est justifiée par l’état de frustration d’un homme oppressé ne trouvant pas d’autre voix à l’expression de sa vraie personnalité. Par cette lecture première, tout le scénario, et même les violences faites aux femmes qui pouvaient passer pour le sujet central, ne semblent qu’une diversion, qu’un prétexte à l’aboutissement final qui permet au shérif d’entraîner son entourage dans la mort (vengeant ainsi dans la fiction, le père réel du réel écrivain). Voilà une histoire qui s’accorde en apparence avec le culte de la responsabilité individuelle du monde anglo-saxon. Mais derrière cette trame codée, « The Killer inside me » est une fiction doublement piégée, si piégée que les adaptations cinématographiques s’y paument. Le film de 2010, en paraphrasant pourtant le roman, n’arrive qu’à illustrer au premier degré quelques scènes pas nécessairement clef qui finissent par contredire la lecture. Contre les a priori sur le genre, « The Killer inside me » est de la littérature et pas du cinéma. Et c’est même presque un cas d’école sur ce qui rend les médiums irréconciliables et sur les erreurs à ne pas commettre, tant, par un seul mot de trop ou l’omission d’un seul, tout est trahi.
Car enfin, au milieu du livre, le retournement.
Il semble que la plupart des lectures zappent ce moment qui pourtant donne son sens entier au livre. Le moment ou le narrateur comprend qu’il se ment. Dans la première partie, notre tueur nous raconte un polar ironique qui permet de justifier des meurtres pour effacer les traces de meurtres précédents, jusqu’à ce que notre meurtrier finisse par comprendre qu’il n’est pas obligé par les événements, mais répond à une pulsion irrépressible, une pulsion de meurtre d’un certain type de femme, toujours le même, de ces femmes qui ressemblent à la bonne et maîtresse de son père qui avait abusé de lui enfant, en l’entraînant dans des fantasmes SM qu’elle pratiquait déjà avec le père… Ce moment de la révélation que le polar de vengeance n’est qu’un prétexte à la répétition d’une scène violente inaugurale est matérialisé par la découverte d’une photo dans un livre de commentaires sur la Bible, une photo de la bonne recroquevillée, pliée en deux, tête entre ses cuisses zébrées de traces de flagellation… Avec ce glissement d’une responsabilité du contexte social présent, oppressif, qui interdit à un homme d’être lui-même et l’enferme toute sa vie dans une imposture, à une responsabilité passée, lointaine, biographique, d’une violeuse perverse qui va fabriquer un pervers par reproduction, le narrateur trouve là la justification de sa reproduction du comportement de son père sadique en déresponsabilisant ce dernier. La Bible donne le cadre : la femme est toujours coupable, d’autant plus ici qu’elle demande à être punie. Mais le lecteur, lui, découvre ainsi le narrateur comme calque de son père : une image sociale irréprochable cachant des pulsions sadiques. Mais plus encore que son père, simplement sadique et hypocrite, lui a « fauté » (même si on ne connaît pas les détails de la faute) avec la maîtresse de son père (donc une mère de substitution, puisque son père l’élève seul), et comme Œdipe, le narrateur doit se découvrir coupable. Mais le livre n’en dédouane pas pour autant l’entourage, ce cadre social pervers présent et passé, gangréné par une incapacité puritaine à gérer les passions et pulsions… Si dans la première partie, le vrai coupable, c’est la société, dans le second, on découvre la culpabilité du père, de son rapport aux femmes, sans pour autant déculpabiliser le présent corrompu et hypocrite du roman.
Le narrateur aussi menteur et violent soit-il, n’est alors qu’un agent particulièrement actif d’une violence globale, d’un mensonge global, et le lynchage n’aura pas lieu comme prévu. Le personnage en entraînant les lyncheurs dans la mort, retourne habillement le sens et les conséquences du sacrifice : À la fin, le tueur, c’est tout le monde, et la culpabilité universellement partagée ne se lavera pas du sacrifice d’un simple bouc émissaire.
La question ici n’est pas savoir si le personnage est coupable, s’il est absolument et totalement coupable et s’il veut juste se dédouaner sur son entourage, mais ce que dit vraiment le livre. Et le livre dit, donc, que le personnage finit par comprendre des choses de lui, sur la manière dont il répète une scène inaugurale traumatique, et par l’entremise de son avocat : « Une mauvaise herbe est une plante qui n’est pas à sa place », il finit par se voir comme le résultat d’une histoire et d’un terrain délétère. Alors, bien loin de l’essentialisme, le jugement éclairé du seul personnage éclairé, l’avocat, oriente la lecture vers un message quasi révolutionnaire qui ne pouvait être audible dans le cadre de la société américaine. Ainsi, même s’il n’est généralement pas reçu comme tel, Jim Thompson est l’auteur de la responsabilité collective. Chez lui, l’individu n’est qu’un rouage d’une machine psychosociale totalitaire qui n’a qu’une issue possible : la violence et la mort. Dans « Pottsville, 1280 Habitants » beaucoup plus bavard, on lit « Lequel d’entre nous exerce pleinement son libre arbitre ? » et plus loin, encore plus explicite « il n’y a pas de péchés individuels. Ils sont tous collectifs, Georges, nous partageons tous les péchés des autres, et ils partagent tous les nôtres. » Pourtant, encore aujourd’hui mal adaptés, les livres de Jim Thompson prêchent dans le désert, et ses personnages continuent de jouer leur rôle de parfait bouc émissaire d’une société qui ne se remet jamais en question.
[ Tiens, à aucun moment je ne cite un héritier, Bret Easton Ellis et son extraordinaire American Psycho… ]
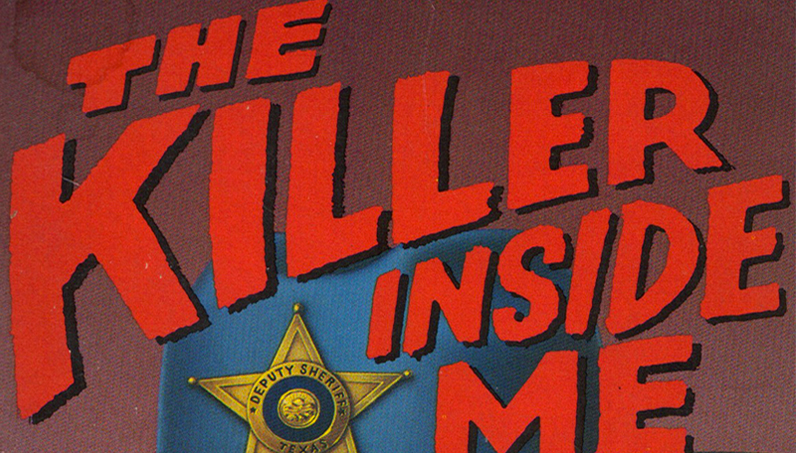
La trilogie de Santa Clara | BONOBO.NET
[…] n’avais jamais entendu parler. Natacha Levet, qui me guide dans le polar contemporain comme Golo et Frank m’indiquaient les classiques, me conseille entre autres un polar pour rire, léger, et […]
Autour de « Le roman noir une histoire française » de Natacha Levet – BONOBO.NET
[…] Une mauvaise herbe est une plante qui n’est pas à sa place […]